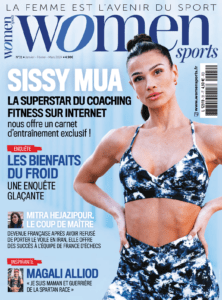L’année 2020 et le premier trimestre 2021 nous ont prouvé qu’avec la pandémie, il fallait lutter contre isolement et sédentarité, deux maux que le sport parvient habituellement à canaliser. Brutalité des annonces de fermetures des gymnases, rideaux métalliques des salles de sport descendus, emportant avec eux parfois la motivation des pratiquants. Le printemps est d’ordinaire le moment de l’année où l’on note un vrai regain d’énergie et de bonnes résolutions sportives. Mais avec tous ces changements, sommes-nous encore motivés à faire du sport ? PAR LÉA BORIE
(Re)bond sportif pendant le confinement
Tout beau tout neuf
Premier constat, avant le confinement, le taux de participation et le nombre d’abonnements des Français n’ont fait qu’augmenter ces trois dernières années, comme nous l’explique Laurent David, directeur Europe Icon Health & Fitness, producteur américain de produits connectés. « Running, fitness, marche nordique, cyclisme… Ces pratiques n’ont fait qu’augmenter pendant les confinements, et le marché continue d’être en croissance. À aucun moment on a pu penser que le sport serait mis de côté par les Français. »
Si l’on observe les chiffres au 2e trimestre 2020, on constate une participation massive à la pratique du sport. Parce qu’on avait peur de prendre du poids à être confiné chez soi toute la journée, parce qu’on avait plus de temps libre sans le temps pour se rendre sur son lieu de travail… En se penchant sur les données recensées par l’application Strava, on note une augmentation de 33 % de téléchargements de l’appli par rapport à l’année précédente, et une communauté agrandie de 2 millions de nouveaux athlètes chaque mois. Celle-ci « a su se mobiliser, s’adapter et inventer de nouvelles façons de se soutenir, de progresser et de se mesurer aux autres, même à distance », détaille le communiqué de presse. Les sportifs déjà enregistrés ont quant à eux augmenté leur fréquence d’entraînement de 13,3 %. Le sport en solitaire a aussi connu une progression, évidemment : 44 % des distances marathons ont été courues en solo contre 14 % en 2019.

Le fitness digital : le roi du monde
Le jour où mon salon est devenu ma salle de sport
« Il y a eu une vraie accélération du digital au premier confinement. Nombre de Français ont découvert la routine sportive pendant ces confinements et n’ont plus l’intention d’arrêter », détaille Arthur Benhamou, fondateur de LaSèche, plateforme de remise en forme.
Dès le mois de mars 2020, Icon Health & Fitness a constaté une accélération incroyable de ses ventes, « un volume incomparable sur ces cinq dernières années, on a presque triplé nos ventes ». L’explication, selon le responsable Laurent David ? « La frustration des salles de sport fermées, qui ont laissé les adeptes sans activité, et les ont obligé à chercher des solutions alternatives. Et même au 2e confinement, beaucoup ont compris que ça allait s’installer et qu’il fallait trouver un moyen d’échapper à cette monotonie par une pratique à la maison. On le ressent car les prévisions de vente se maintiennent. »
Durant cette année écoulée, cette accélération de la pratique sportive à domicile s’est traduite par la multiplication d’offres non structurées – des coaches sur les réseaux sociaux qui dispensent des cours à leur communauté – mais aussi le développement massif d’applications. Les Français ont découvert une nouvelle approche de l’activité sportive : le sport à la demande depuis son salon. Certaines applications entendent même entretenir l’esprit d’équipe et le lien social. Elles se donnent le pari de garder les communautés sportives soudées, même en dehors du terrain. Par exemple, le concept Squadeasy permet aux collaborateurs d’une même entreprise de relever des défis sportifs en équipe, même à distance. « Vous obtenez des points en effectuant des activités, pour ensuite faire gagner votre équipe, nous explique Claire Vargel, responsable marketing de Squadeasy. Des challenges solidaires ont été mis en place à distance pour resolidariser les équipes et permettre de s’engager pour un projet qui fait sens, comme celui où chaque pas effectué par un salarié est monétisé en don pour l’AP-HP (le CHU d’Ile-de-France). Ou sous une forme similaire avec Pure Projet pour lutter contre la déforestation ».
Mais ces solutions innovantes n’ont pas pu pallier à toutes les formes de démotivation et éviter le décrochage chez d’autres sportifs.
Démotivation covid quand les sportifs décrochent
Sédentarité et démotivation crescendo
Dans son analyse, l’Observatoire des publics et des pratiques de la FFEPGV (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire) a révélé qu’entre les confinements, les restrictions liées à la pratique sportive et le télétravail imposé, la sédentarité a augmenté. Les clubs EPGV ont lancé des programmes sportifs en ligne. Seulement, encore faut-il être réceptif à cette méthode et assez initié numériquement pour pratiquer via un écran.
Il y a eu aussi un effet soufflé qui retombe après l’excitation des débuts. « Après la première vague de Covid-19, tout a commencé à revenir à peu près à la normale », d’après le communiqué Strava. Aussi parce que le digital a probablement ses limites. Au bilan, le baromètre sport santé FFEPGV / Ipsos – 10ème édition – résultat d’une enquête menée en décembre 2020 – fait état d’une pratique sportive en recul chez les femmes. « La crise sanitaire creuse d’avantage les inégalités d’accès à la pratique sportive (…), 67 % de femmes déclarent avoir eu plus de difficultés à pratiquer une activité physique », ajoute le communiqué.
« Il faut dire aussi qu’il y a eu un amalgame entre cette situation sanitaire et un engagement un peu à la va-vite, pose Nicolas Hauw, maître de conférences spécialisé dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives. On pourrait même parler d’instrumentalisation de la pratique de l’activité physique dans un contexte anxiogène, avec une pression notamment sur les personnes fragiles, dites à risque. On a vu la différence entre les confinements. Au premier confinement, les Français avaient une heure d’activité physique par jour et en profitaient pour sortir se dépenser, mais beaucoup ont arrêté cette routine après coup ».

Expliquer la baisse de motivation
Le manque de motivation s’observe sur trois critères d’après Ludovic Savariello, expert en performance : tout d’abord lors de baisses d’énergie, qui nous font rentrer dans un cercle vicieux. Ce qui engendre des pensées négatives : les participants relèvent davantage ce qui les empêche plus que ce qu’ils peuvent y gagner. Et dernièrement s’installe la procrastination.
Une idée appuyée par Christel Abbate psychologue clinicienne spécialisée dans le suivi de sportifs : « Moins on est motivé, moins on en fait et cela diminue notre sentiment d’auto-efficacité. À la reprise, on n’a plus les mêmes capacités physiques. Un processus tel une spirale descendante se met alors en place. On se sent en échec et on perd son estime de soi sur le plan physique. »
Démotivation à l’ère de la pandémie : l’incertitude est reine
« Jusqu’à présent, avec cette crise, on avait la capacité de se dire qu’on allait s’en sortir. Maintenant, on entend davantage de discours de désespoir. On ne sait plus vraiment quand on va s’en sortir, les risques nous menacent, ce qui rend la situation confuse », analyse Arthur Benhamou de LaSèche. L’éclairage apporté par les neurosciences américaines cette dernière décennie nous a prouvé que le cerveau est un système prédictif, comme nous l’explique Ludovic Savariello. « Or, la crise sanitaire nous a plongé dans une incertitude totale, ce qui épuise les cerveaux avant même de savoir s’ils sont motivés. Quantité de gens s’attendent à ce que la situation redevienne comme avant, que la carotte soit mise au même endroit. Mais c’est sans prendre en considération le changement de situation. Le manque de motivation va de pair avec le manque de repères, alors qu’il faut trouver ces repères en nous, et non dans le monde extérieur ».
La psychologue Christel Abbate l’a constaté chez les jeunes sportifs qu’elle accompagne : « ça questionne le sens qu’ils mettent dans leur sport. Quand il y a une perte de sens, la motivation se perd aussi. Mon travail, en partenariat avec les entraîneurs, est de les aider à mettre en lumière leur raison d’être, ce pour quoi ils font tel sport. Et si malgré cela, il y a décrochage, c’est peut-être que ce sport n’avait pas tant de sens que ça pour eux. Souvent c’est ce qu’il se passe. On parle alors de motivation extrinsèque, issue du regard de l’autre (quand on fait du sport pour faire plaisir à ses parents, son conjoint, qu’on va s’entraîner pour ses amis, qu’on pratique pour son apparence, pour gagner une coupe et être valorisé…). Cela fragilise le processus d’engagement ; ces motivations externes sont beaucoup plus sensibles au stress et à l’anxiété. »

Il y a aussi les occasions manquées. Christel Abbate accompagne l’équipe de France de short-track (patineurs de vitesse sur courte piste). « La question qui se pose pour les joueurs avec l’arrêt des compétitions est de savoir comment s’accrocher sans rivalité ni combativité pour évaluer les effets de leur entraînement ». La psychologue pense également à des jeunes en pôle espoir de ski freestyle au lycée climatique et sportif Pierre de Coubertin de Font-Romeu : « Ils ont vu les vidéos de figures de leurs concurrents en Suisse, à l’époque autorisés à pratiquer et pas eux, et avaient l’impression de ne pas faire ce qu’il fallait pour garder le niveau ».
Le processus motivationnel est très puissant dans le sport de compétition, comme nous le détaille Nicolas Hauw, de l’Institut de formation en éducation physique et sportive d’Angers : « Chez le compétiteur, il n’y a que la compétition sur laquelle s’appuyer pour obtenir ce feedback qui l’aide dans sa préparation. De plus, en confinement, les sportifs se sont retrouvés seuls à gérer leurs entraînements. Tout ceci a généré de l’anxiété chez les athlètes, comme le démontre une étude de l’Insep, en particulier chez les femmes. De plus, celle-ci a révélé une augmentation du temps sédentaire chez ces sportifs de haut niveau, eux qui habituellement se déplacent en mode doux pour leurs activités. Avec cette sensation d’avoir été enfermés, contrôlés, ils ont été davantage à la recherche d’opportunités d’activités, ce qui a pu révéler blessures, addictions et mauvaise gestion des émotions. »
L’autre risque aussi à moins pratiquer est de générer des frustrations, qui s’accompagnent de négativité. « Chez les sportifs appartenant à un club, à une équipe, on a vu aussi des états dépressifs apparaître. L’identité sociale, l’appartenance à un groupe est liée au soutien social. Or, les personnes qui se sont retrouvées isolées sans pouvoir pratiquer avec leur équipe en ont souffert ».
Court terme et plaisir : comment je rapproche mes objectifs
« On passe son temps à réfléchir à ce qu’on va faire tout de suite, comme lorsqu’on déplie son pied pour marcher. Ce qui demande d’avoir des objectifs à court terme pour s’accrocher, étaye Ludovic Savariello. Quand Camille Lacourt nageait six heures par jour pour éventuellement gagner les JO dans quatre ans, ce n’était pas cette compétition qui le sortait du lit le matin. Il n’y a rien de plus barbant que de se lever à 6h pour nager des heures dans une piscine olympique. Le schéma à court terme ‘‘motivation = récompense’’ tient si le nageur trouve du plaisir. Son truc à Camille, c’était le plongeon du dauphin à la fin de sa séance de nage ».
Explication qu’on retrouve chez la psychologue clinicienne Christel Abbate. « Les jeunes sportifs sont formatés, conditionnés depuis qu’ils sont petits à avoir dans le viseur les prochaines compétitions. Le sens de leur sport devient ces compétitions. Ce qui est intéressant pendant cette crise, c’est de comprendre que leur sport, ce n’est pas seulement de performer pendant une compétition, mais de savoir pourquoi on se lève à 6h pour être au bassin à 7 et aller en cours à 8. C’est un engagement si lourd que s’ils n’y mettent pas plus de sens que simplement de gagner des compétitions, ils perdront leur motivation. (…) On met alors en place des stratégies. Si l’objectif est de faire les JO, on va transformer ça en petits objectifs à courts termes pour cibler ce sur quoi travailler chaque semaine ».
Trouver sa force
Faire la place à sa vraie motivation
« Avant covid, l’entraînement quotidien était motivé par la perspective de compétition et de résultat de médaille potentielle, relate Ludovic Savariello. Il faut retrouver du pur plaisir à s’entraîner ». Une dimension qui peut amener les sportifs plus loin. Sa solution pour faire revenir les décrocheurs : travailler à l’envers, et leur demander en préambule ce qui leur plait, pour leur apprendre à réfléchir au plaisir qu’ils trouvent dans leur sport. « Quelqu’un qui sait comment il fonctionne ne perdra pas sa motivation. C’est ainsi que certains sportifs ont su tirer leur épingle du jeu durant la pandémie ».
Un cadeau pour chacun : du temps pour se recentrer
Sans compétition, pas d’élément de comparaison. D’où ce sentiment de « végéter » dans son sport. « Mais on peut palier à ça, argumente la psychologue du sport, en représentant sur une échelle graduée ce que le sportif a mis en place, lister les stages, les blocs d’entraînements et les techniques apprises qui s’y réfèrent. Ce qui fait comprendre aux sportifs que ce n’est pas du temps perdu. Mieux, ça les aide à remettre du sens, de l’estime de soi, de la confiance en soi, de l’engagement. Et on a le temps de le faire, ce qui ne serait pas le cas sur une saison normale. Des sportifs ont par exemple pu se concentrer sur des vidéos de leur discipline pour en apprendre davantage sur leur sport, et ont gardé en tête cette phrase : ‘‘Mon objectif est de progresser, pas forcément de gagner’’. »
« Mieux encore, des études post-confinement ont prouvé que des sportifs de haut niveau avaient obtenu de meilleurs résultats avec des entraînements moins intensifs pendant la période de Covid-19. La charge d’entraînement est parfois tellement lourde que cela empêche le processus de performance. On a le sentiment que c’est avec la quantité uniquement qu’on va performer, mais en réduisant cette dose d’entraînement, cela peut permettre d’avoir une approche plus globale de son activité, ce qui peut être probant chez certains. »

D’autres avantages sont relevés par Nicolas Hauw : « On l’a vu chez certains sportifs autonomes avec un faible niveau d’anxiété, ils ont pu profiter de cette période pour différentes raisons : souffler, se donner du temps pour réfléchir, aller vers des pratiques douces et méditatives… Certains sont même allés voir des sports totalement opposés à leur pratique, pour s’initier, se stimuler, prendre toutes les expériences corporelles possibles, non pas pour absolument rester en forme, comme dans le grand réflexe du premier confinement, mais pour la qualité de l’expérience sportive. Une chose rendue possible grâce à la créativité de certains clubs pour rendre leur activité plus accessible malgré des conditions sanitaires strictes. Ce qui est très motivant pour la personne qui s’essaye à un nouveau sport, car lorsqu’on débute une activité, la répétition génère l’apprentissage. Si on ne vise pas trop haut, on se retrouve vite en posture de réussite. Si on accepte de n’avoir rien à perdre et de montrer notre incompétence, cela génère à moyen terme un engagement ! »
La passion, meilleure des actions : identifier ses propres ressources
Il est grand temps de retrouver une motivation intrinsèque à pratiquer son sport, la passion, la progression, pour se réapproprier son activité. « Cela passera peut-être par une redéfinition de son projet sportif, prévient Christel Abbate. Savoir pour quelle raison précise s’entraîner permet de cibler de quelle façon on va le faire. En répondant à cette première question, il faudra se demander ce dont on a besoin pour y parvenir, afin d’identifier les ressources intérieures et extérieures nécessaires, ainsi que les freins. Une démarche qui doit permettre de contourner les difficultés et de s’engager dans un nouveau processus qui aide à avancer. Ce qui est très important en cette période de pandémie car cela aide la personne à reprendre le pouvoir et à être actrice de son projet malgré les interdictions et les incertitudes. »
Documentations et ressources
- Théorie de la motivation et pratiques sportives. Etat des recherches, Philippe Sarrazin, François Cury, édition PUF, 2001
- Comment remettre la performance sportive en marche lorsqu’elle s’est mise en pause ?, article sur le blog ludovic-savariello.com
- Profil motivationnel et performance sportive, N. Gillet, S. Berjot , B. Paty, Laboratoire de psychologie appliquée, 2009
- Post-confinement : une reprise progressive, maîtrisée et adaptée à l’Insep, Insep le mag N°39 – juin/juillet/août 2020
- La pratique physique et sportive des Français sous le signe du premier confinement, Injep Analyses & Synthèses, n°45, février 2021
Remerciements
- Christel Abbate, psychologue clinicienne spécialisée dans le suivi des sportifs, préparatrice mentale de sportifs de haut niveau au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive)-CNEA (Centre national d’entraînement en altitude) de Font-Romeu.
- Ludovic Savariello, expert en performance, coach professionnel accompagnant les sportifs de haut niveau. Maitre praticien en hypnose ericksonienne, hypnose et sport et programmation neurolinguistique, professeur de yoga, éducateur sportif et ingénieur centralien.
- Nicolas Hauw, maître de conférences en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l’IFEPSA-UCO (Institut de formation en éducation physique et en sports d’Angers – Université catholique de l’Ouest).












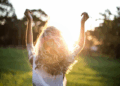

![[LE SAVIEZ-VOUS ?] Quels sont les sports mixtes ?](https://www.womensports.fr/wp-content/uploads/2018/07/Capture-d’écran-2018-07-31-à-20.07.05.png)